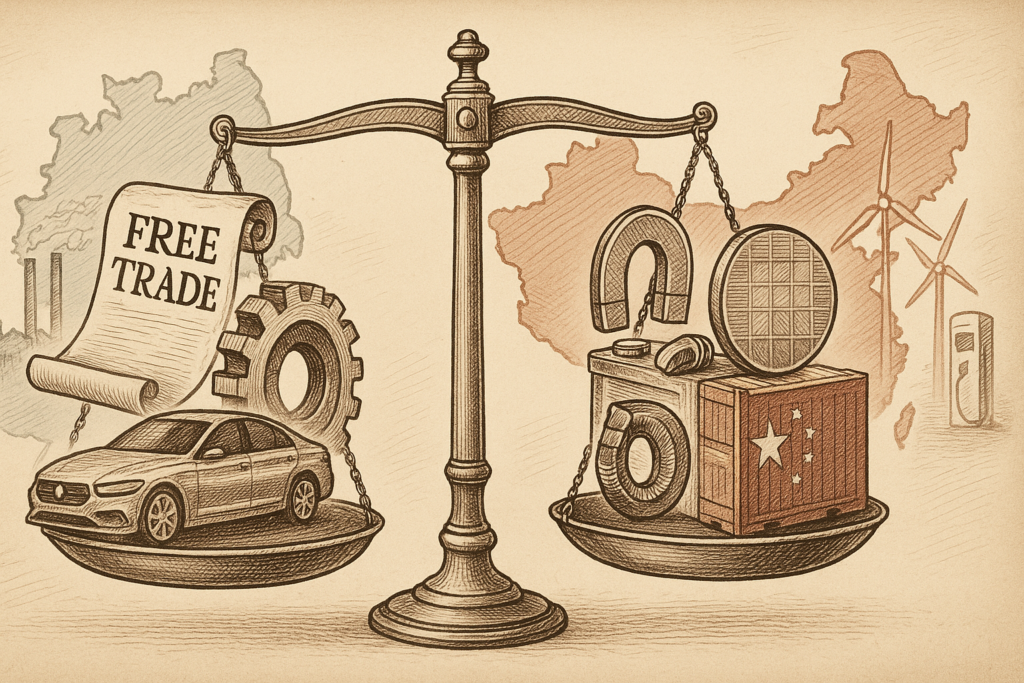
Dans un article du Monde consacré aux tensions entre Berlin et Pékin, la journaliste écrit : « Le changement de paradigme dans les échanges internationaux, où la domination stratégique des ressources et matières premières, des technologies sensibles et des marchés a remplacé les règles du libre-échange, a détérioré la position des entreprises allemandes1. »
Cette affirmation soulève une question : est‑ce réellement la domination stratégique des matières premières et des technologies sensibles qui aurait remplacé le libre‑échange ? Ou bien les pays occidentaux ont‑ils plutôt perdu la domination technologique qui leur permettait, jusque‑là, de contrôler l’accès aux matières premières extraites dans les pays en développement et de pratiquer un « libre‑échange » à leur avantage ?
Comment fonctionnait l’ancien système (années 1990‑2010)
Après la fin de la guerre froide, le récit dominant en Occident était simple : ouverture des marchés, règles de l’OMC, chaînes de valeur mondialisées. Les entreprises américaines, japonaises et européennes gardaient les segments à forte valeur ajoutée – brevets, conception des systèmes, machines‑outils de précision, chimie avancée, automobile – et externalisaient la production à forte intensité de main‑d’œuvre vers des zones à bas salaires. L’accès aux matières premières venues du reste du monde allait de soi. L’énergie et les matières premières fournis par des partenaires politiquement sensibles (le gaz russe pour l’industrie allemande, les minerais rares venus de Chine, etc.) étaient perçus comme des risques gérables, pas comme des menaces pour la sécurité nationale.
L’industrie allemande, en particulier, a bâti son modèle sur deux piliers : (1) une énergie, des matières premières et des composants importés à bas coût ; (2) l’exportation massive de biens manufacturés haut de gamme (surtout des voitures et des machines) vers des marchés en forte croissance comme la Chine. Quand l’Union européenne ou Berlin parlait de « libre‑échange », elle désignait en réalité le bon fonctionnement de ce modèle.
Dans cet univers, l’Occident pouvait se dire libre‑échangiste parce qu’en pratique il contrôlait l’essentiel des goulets d’étranglement : finance, brevets technologiques, normes industrielles. Si un pays du Sud produisait du cobalt, du lithium ou des terres rares, ce sont le plus souvent des firmes occidentales – puis, plus tard, chinoises – qui maîtrisaient l’étape décisive : le raffinage, les outillages, les machines permettant de transformer le minerai brut en intrant industriel à forte marge. L’« ordre fondé sur des règles » reposait sur ces hiérarchies2.
Le tournant des années 2020
Dans les années 2020, les matières premières critiques deviennent un instrument de pression explicite. La Chine traite et raffine une part conséquente des terres rares, du graphite de qualité batterie et de métaux comme le gallium et le germanium, indispensables aux semi‑conducteurs, aux moteurs de véhicules électriques, aux éoliennes, aux radars et à d’autres technologies à double usage (militaire et civil). Pékin met en place des licences d’exportation, des quotas ou des interdictions pures et simples sur certains de ces produits, et limite l’envoi de certains minerais – ainsi que du savoir‑faire associé – à ses rivaux. Le discours est assumé : il s’agit de sécurité nationale. L’impact est immédiat pour l’Allemagne, dont l’industrie dépend massivement des terres rares et des aimants permanents produits en Chine – avec, pour certaines composantes, plus de 90 % de dépendance3.
Dans le même mouvement, les technologies avancées – y compris celles qui paraissent « civiles », comme les batteries, les plates‑formes de véhicules électriques, les équipements de fabrication de semi‑conducteurs ou la robotique industrielle – sont désormais traitées comme des actifs stratégiques et non plus comme de simples biens échangeables.
Les États‑Unis et leurs alliés restreignent depuis longtemps le transfert de technologies de pointe : pas seulement les missiles ou le nucléaire, mais aussi l’aéronautique, l’informatique, les télécommunications et la fabrication avancée4. Ce qui change aujourd’hui, c’est que cette logique de sécurité sort des régimes spécialisés de contrôle des exportations ou des barrières de brevets et s’étend désormais à des filières civiles entières.
Dans cette perspective, les pays occidentaux restreignent l’accès de la Chine aux machines de pointe et aux puces les plus avancées, en expliquant que la capacité de calcul haute performance relève désormais de la sécurité nationale. Pékin répond en resserrant l’accès aux minerais et aux intrants transformés dont ces mêmes puces, ces batteries et les technologies vertes dépendent. En Europe, Bruxelles ouvre en 2023 une enquête antisubventions sur les véhicules électriques chinois et affiche clairement sa volonté de recourir à des droits de douane ou à d’autres instruments défensifs pour protéger les constructeurs européens. C’est une rupture nette après des décennies de discours libre‑échangiste5.
Simultanément, de nouveaux mots d’ordre s’imposent à Berlin et à Bruxelles : « sécurité économique », « réduction des risques » (de‑risking), « autonomie stratégique ». L’Acte sur les matières premières critiques de la Commission européenne fixe désormais des objectifs chiffrés à l’horizon 2030 pour l’extraction, le raffinage et le recyclage au sein de l’Union d’intrants jugés stratégiques (terres rares, lithium, cobalt, etc.), ainsi que pour la diversification des sources d’approvisionnement. Le message est clair : ne plus jamais dépendre d’un seul pays – hier la Russie pour le gaz, aujourd’hui la Chine pour les aimants, les batteries et des composants clés. Les gouvernements réorganisent ouvertement le commerce autour du contrôle des matériaux, des technologies et des chaînes de valeur complètes. C’est une vraie rupture par rapport au discours des années 19906.
Les entreprises allemandes se sentent particulièrement exposées
L’Allemagne n’est pas seulement une victime malchanceuse dans cette histoire. Son industrie a volontairement optimisé son modèle autour du gaz russe bon marché acheminé par gazoducs et autour de l’accès à la demande chinoise, parce que cette combinaison maximisait la compétitivité et les profits depuis vingt ans. Berlin a supposé que ces deux flux – l’énergie qui entre, les exportations qui sortent – resteraient disponibles et politiquement neutres. Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022 et dans le contexte de l’affrontement actuel avec la Chine, les responsables allemands décrivent désormais cette dépendance comme une vulnérabilité stratégique, et non plus comme un simple choix d’efficacité économique.
L’industrie manufacturière allemande (automobile, éolien, électronique, machines‑outils) dépend fortement des terres rares chinoises, des aimants permanents, des composants de batteries et d’autres intrants critiques. Dans le même temps, les constructeurs allemands écoulent en Chine une part considérable de leurs véhicules les plus rentables et s’appuient sur des coentreprises locales. Ils se retrouvent donc pris en étau entre la nouvelle posture défensive de Bruxelles et la capacité de Pékin à riposter. L’Allemagne est passée de « nous exportons de la technologie sophistiquée et nous importons des intrants bon marché » à « nous dépendons désormais d’un concurrent systémique à la fois pour nos approvisionnements et pour nos débouchés – et ce rival peut fermer les vannes ».
Un basculement du rapport de force
La version occidentale, confortable, du « libre‑échange » reposait sur l’hypothèse que l’Occident – et non la Chine – garderait la main sur les technologies les plus en pointe, et que les intrants critiques continueraient d’affluer librement de l’étranger. Cette hypothèse ne tient plus, en particulier pour les batteries, les véhicules électriques, les composants d’éoliennes et les minerais situés en amont de ces filières – des domaines dans lesquels la Chine n’est pas seulement un fournisseur indispensable, mais surtout un rival systémique.
À mesure que cette asymétrie s’érode, les gouvernements occidentaux (y compris l’Allemagne et l’Union européenne) se tournent vers la politique industrielle, le nationalisme des ressources, les contrôles à l’exportation, les droits de douane et la « réduction des risques ». Ils cherchent à reconstituer une marge de manœuvre stratégique – sur leur propre sol ou avec des partenaires jugés fiables – plutôt que de compter sur les seules règles du libre‑échange multilatéral.
Il est donc inexact d’affirmer simplement que « le libre‑échange a été remplacé par une domination stratégique ». Ce qui a changé d’abord, c’est le rapport de force. Parce que la Chine peut désormais instrumentaliser à la fois les minerais et des pans entiers de l’industrie de moyenne et haute technologie, l’Europe et les États‑Unis parlent désormais des matières premières et des technologies avancées comme d’actifs de sécurité, et non comme de biens neutres – et cette logique ne se limite plus à l’aéronautique, aux télécommunications ou au calcul haute performance. Bruxelles applique désormais le vocabulaire de la « sécurité économique » aux véhicules électriques, aux éoliennes, aux batteries, aux aimants permanents et aux minerais critiques. Le tournant n’est pas que l’Occident découvre soudain que la technologie est stratégique – il l’a toujours su pour les secteurs de pointe. Le tournant, c’est la volonté de sécuriser toute la chaîne de valeur, de l’extraction au raffinage jusqu’au débouché final, dans des secteurs que l’Allemagne considérait encore récemment comme du commerce extérieur ordinaire. Pour l’Union européenne, et tout particulièrement pour l’ancien modèle allemand (gaz russe bon marché à l’entrée, exportations industrielles haut de gamme vers la Chine à la sortie), cela revient presque à rompre avec la posture libre‑échangiste précédente.
Notes
1 « Tensions accrues sur le commerce et Taïwan entre Berlin et Pékin », Le Monde, 26 octobre 2025.
2 Sur le modèle allemand fondé sur le gaz russe bon marché acheminé par gazoducs et sur la demande chinoise pour les voitures et les machines allemandes, voir les débats au ministère fédéral de l’Économie et de la Protection du climat après l’invasion russe de l’Ukraine en 2022, notamment les déclarations publiques de Robert Habeck et d’Olaf Scholz en 2022‑2023 au sujet de la dépendance excessive au gaz russe et au marché chinois.
3 Les mesures chinoises de juillet 2023 imposant des licences d’exportation sur le gallium et le germanium, ainsi que la position dominante de la Chine dans le raffinage des terres rares et la fabrication d’aimants, ont été justifiées au nom de la sécurité nationale. Elles ont rendu visible la dépendance européenne – en particulier allemande – vis‑à‑vis des intrants chinois pour les véhicules électriques, les éoliennes et l’électronique avancée.
4 Sur les régimes occidentaux de contrôle des exportations : le CoCom (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls, 1949‑1994) puis l’Arrangement de Wassenaar (à partir de 1996) encadrent la circulation des biens et technologies à double usage entre États participants.
5 En octobre 2023, la Commission européenne a ouvert une enquête antisubventions sur les importations de véhicules électriques à batterie en provenance de Chine et indiqué qu’elle était prête à appliquer des droits compensateurs pour protéger l’industrie automobile européenne, signalant un tournant plus protectionniste par rapport à la posture traditionnelle de libre‑échange de l’Union européenne.
6 La proposition d’Acte sur les matières premières critiques (Critical Raw Materials Act) de la Commission européenne, conjuguée à la stratégie de sécurité économique européenne (European Economic Security Strategy, juin 2023), fixe des objectifs à 2030 pour extraire, transformer et recycler ces intrants au sein de l’Union, et appelle à « réduction des risques » en limitant la dépendance à un seul fournisseur plutôt qu’en pariant sur la bienveillance durable des marchés mondiaux.